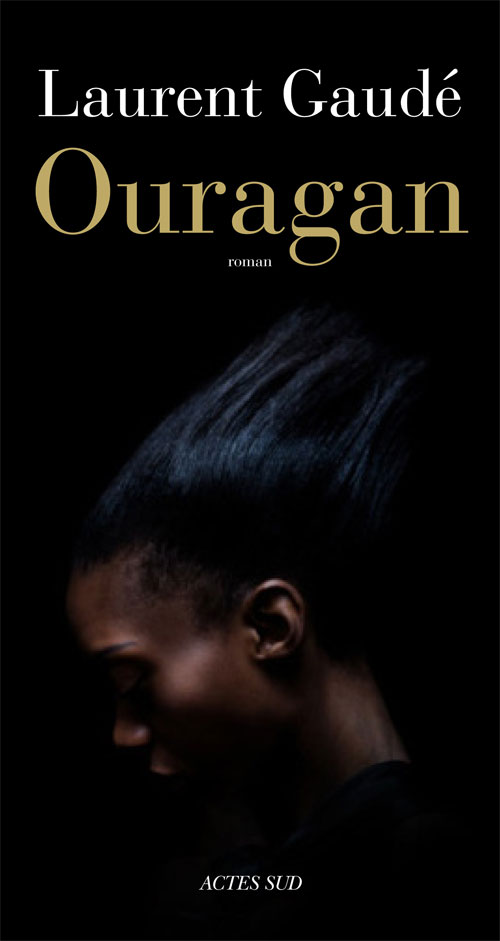Sur scène, le drame se noue, les amants s’enchevêtrent, regards intenses aux yeux maquillés. Les corps se contorsionnent avec une légèreté surnaturelle. Pointes et tutus autour d’eux figurent une forêt mouvante. La musique plane sans que quiconque lui prête attention. Les ors resplendissent comme au premier jour et ceux qui s’ennuient regardent le plafond. Ça suffit bien. La salle bruisse doucement dans le noir.
Vingt minutes plus tôt, en s’installant, Gérard Farchel a déclaré à Sophie : « Tu sais, ma chérie, c’est drôle que tu m’emmènes au ballet. Ça fait des dizaines d’années que je n’y suis pas retourné. Depuis New York … J’allais voir Olga.» Sophie s’est esclaffé « C’est qui ça, Olga ? » « Olga ? C’était une grande danseuse. Du Bolchoï s’il te plaît. ». Elle a regardé son père avec un peu d’indulgence, comme un enfant qui raconte des salades, et s’est plongée dans le programme. Gérard bougonne dans son coin. Avec sa vie si bien rangée, sa fille ne comprend pas du tout la. Ah… Olga. Elle s’appelait Maria mais avait changé son nom pour faire plus russe. Olga…D’ailleurs cette jeune femme qui évolue sur scène, là-bas, a quelque chose d’elle. Une grâce fluide, une tendresse dans les bras… Oui, rêve Gérard, on aurait envie de soulever cette femme-là contre soi, de toucher cette chair si vive. Une étoile qui rebondit magiquement sur le sol, toute faite d’énergie et tendue vers un seul but. Un soir, Olga lui avait promis dans les yeux que chacun de ses gestes sur scène seraient pour lui. Rien que pour lui. Il avait passé la soirée entière cloué sur son siège, tendu comme un arc, ressentant dans sa chair les moindres variations de l’émotion d’Olga. Alors ce soir, en souvenir, il se laisse émouvoir par la parfaite icône qui réitère sous ses yeux l’ancien jeu.
Un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et huit. Le pied tourne en l’air, la pointe adéquate, le menton ni trop levé (ça fait canard) ni trop bas (à cause de son cou trop court), Cécile achève un mouvement sur le temps. Elle corrige discrètement un angle de ses pieds, la courbure de ses doigts. Ce n’est pas une répétition. Ici, c’est la scène. La vraie. Jouer. Être parfaite, précise. Comme Sarah-Anaïs Langlois qui évolue là-bas, idole inaccessible, amour fou. Cécile s’applique à se fondre dans un seul grand corps avec les autres. Toutes sont jeunes, ambitieuses. Comme elle, plus qu’elle. Ensemble, elles sont le vent dans les arbres autour des amants qui virevoltent. Quand vous dansez, sentez le vent sur vos mains, et n’abimez pas les branches, a dit le maître de ballet. Alors, chacune pose légèrement son pied sur chaque note, trottinant sans brutalité le long de la mélodie. Un et deux et trois quatre et cinq…. Personne ne regarde Cécile. En deux ans, c’est la troisième fois qu’elle danse sur scène. C’est la première fois qu’elle danse si près de Langlois. Elle l’observe discrètement, inquiète de se perdre dans ses pas mais elle ne peut pas la lâcher des yeux. Langlois et Hector s’enlacent comme deux oiseaux amoureux, avec une telle tendresse que Cécile a envie de pleurer. Elle tourne et s’enroule autour de lui, de ses bras, de son torse, s’envole à nouveau. Merveilleuse apesanteur. C’est cette femme qui a fait rêver Cécile de danser pour de vrai, après des années de conservatoire. Heureuse soudain, elle sourit au noir devant elle.
Asma baille encore une fois et peste contre cet inexplicable épuisement qui l’accable depuis quelques temps. Asma est ouvreuse. Officiellement pour gagner un peu d’argent : sa bourse de thèse est un peu courte. En réalité, elle est là pour voir et revoir ce spectacle. Les fois précédentes, une fois expédiés les petits problèmes de places, de conflits et de retards, elle est restée là, subjuguée. Asma adore le ballet. Elle oublie tout, elle disparaît dans la musique et la perfection des mouvements. Elle attend particulièrement la scène de la fontaine où Sarah-Anaïs Langlois pleure. Sans bouger le visage, sans sortit un son : elle pleure avec le corps. C’est à la fin du spectacle, quand la danseuse a pu sentir leur peine à tous qui la regardent en silence. Asma se concentre. La foule des petits rats ondule tranquillement. Les danseuses figurent des arbres, c’est écrit dans le programme qu’elle connaît par cœur. C’est bien vu. On devrait voir plus souvent des arbres. Elle pense à la dernière fois qu’elle a vu une forêt. Elle a fait l’amour dans cette forêt. Le souvenir lui arrache un sourire. Une tendresse au fond d’elle pour son homme. Il y a un mois et demi ? Elle cherche des repères. Deux mois ? Déjà ? Mais alors… D’un coup, elle transpire, soudain fébrile, compte les semaines, un grand silence suspendu en elle, comme un battement de cœur qui manque.
Gérard danse les yeux mi-clos avec Olga retrouvée.
Cécile a trouvé son rythme, elle tourne et vire, extatique.
Asma : c’est pas possible. Je suis enceinte.
Et c’est à ce moment là, précisément, qu’un mauvais appui, un temps suspendu et ce bruit : badablam. Bruit honni des danseurs, celui du parquet qui trahit et d’un coup résonne sous le poids de la danseuse. Sarah-Anaïs Langlois est au sol. La salle s’unit dans un même cri qui la laisse en apnée, les poumons prêts à éclater.
Olga ? murmure un vieux monsieur au troisième rang, faisant sursauter sa voisine de gauche, une belle femme blonde de la quarantaine.
Mon cœur ne bat plus. Je vais mourir là, constate Cécile dont la ronde continue à vide.
Au fond, Asma plie sous le choc, le souffle coupé. Oh mon dieu. Enceinte.
Brusquement extrait de sa rêverie Gérard est si près qu’il peut voir la consternation sur les visages sur scène, à deux pas, sauf celui de Langlois qui se cache derrière son coude. Puis la jeune femme fait un signe et des hommes en noir l’entraînent doucement en coulisse. Toute la scène est immobile en plein geste. Seules les poitrines se soulèvent rapidement. Hector Nurescu a l’air de quelqu’un qui a perdu ses clés. Gérard aussi est seul, plus trop sûr d’où il se trouve, ni quand. Olga l’a quitté il y a bien longtemps. Elle est peut être déjà morte ou épave quelque part. Elle buvait trop.
Elle va revenir. Ce n’est pas possible. Un coup de bombe glaciale et elle va revenir. Cécile se mort la lèvre derrière son sourire. Si elle ne revient pas, je ne danserai plus jamais.
Que s’est il passé ? Je ne regardais pas… Les sièges craquent, les gens se penchent les uns vers les autres, chuchotent à toute vitesse. Asma voudrait disparaître. Mon dieu, j’ai perdu le fil, c’est terrible. Et maintenant elle est tombée. D’un même mouvement, quelques visages se tournent vers elle : on l’interroge du regard. Elle panique, lutte contre l'envie de s'excuser, l’impulsion soudaine de monter sur scène reprendre le rôle, sauver la situation.
L’orchestre flotte à peine, entonne la suite, reprend en boucle mais Sarah-Anaïs Langlois ne reparaît pas. Enfin une silhouette en justaucorps fluo déboule sur la scène : une glissade, un port de bras. Sous les timides applaudissements de ceux qui ont compris, Katia Levesque prend la position. D’un signe de tête, elle relance l’orchestre, et voila Hector en grande tenue qui étreint une étoile sans tutu. Réglé comme une horloge, le ballet se remet en marche.
Gérard hésite, étouffe une quinte de toux. Il sourit vaguement à sa fille qui lui dit quelque chose qu’il n’entend pas. S’accroche à son rêve. Avec un peu de mauvaise fois, on peut y croire encore. Oui, voilà, Olga est revenue, dans ses bras de nouveau. Elle guide une valse lente. Elle dit qu’elle restera toujours. Tendrement, il ferme les yeux.
C'est fini. Cécile se sent trahie à jamais. Levesque qui danse là-bas avec Hector, le justaucorps qui jure. C’est terrible. Soudain le public qui bruisse, à l’abri dans le noir impénétrable, lui semble violemment près. Elle danse comme une automate. Ce sont des cannibales. Elle les hait.
Sans faire de bruit, cramponnée à sa pile de programmes, Asma pousse discrètement une porte à abattants. Dans la solitude du couloir circulaire, à peine consciente de la violence soudaine de l'éclairage, elle se pelotonne sur une banquette de velours. Là, longuement, elle pense à Sarah-Anaïs Langlois dont la vie est en train de basculer en coulisses. Puis elle rentre en elle-même et ne pense plus à rien. Rien du tout.